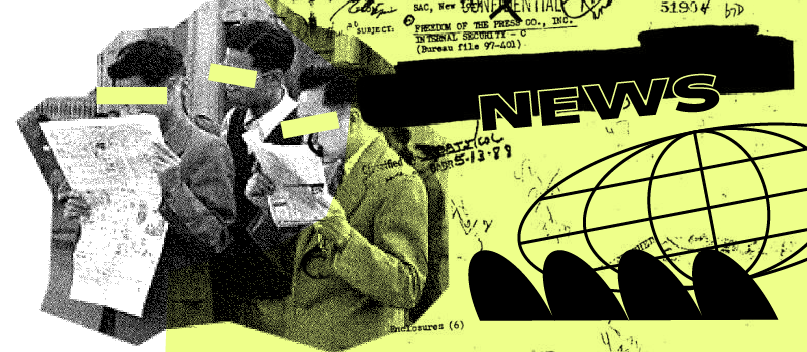À quoi ressemblera le travail de demain ? Pour Muriel Pénicaud, impossible de répondre à cette question sans débattre collectivement – et sans s’adresser à toutes les générations. Ex-ministre du Travail et ambassadrice auprès de l’OCDE, aujourd’hui photographe, scénariste, keynote speaker, dirigeante d’entreprise et présidente du fonds mécène Sakura, elle signe avec le journaliste Mathieu Charrier Travailler Demain (Éditions Glénat, sortie le 9 avril), une bande dessinée documentaire qui met en scène treize personnalités du monde économique, syndical, scientifique ou entrepreneurial. Un projet ambitieux, à la fois documenté et accessible, pour mieux comprendre les bouleversements du monde du travail – et surtout, apprendre à les façonner dès aujourd’hui.
Pourquoi avoir choisi de traiter un sujet aussi vertigineux que le futur du travail sous forme de bande dessinée ?
Muriel Pénicaud : J’ai toujours été passionnée par ce sujet. Je donne beaucoup de conférences en France comme à l’étranger – aux États-Unis, en Inde, en Grèce, etc. Mais à un moment, j’ai ressenti le besoin de proposer un outil de débat pour un plus large public. Ce qui se joue est immense : intelligence artificielle, transition écologique, vieillissement de la population, évolution des rapports au travail… Tout ceci crée une vague de transformation inédite. Et puis, j’adore la BD ! C’est un médium idéal pour toucher toutes les générations. On peut parler de sujets sérieux sans être austère, et je trouvais cela beaucoup plus accessible qu’un essai. En langue française, on a cette chance de pouvoir miser sur le roman graphique pour transmettre.
Vous avez fait le choix de mettre en scène 13 personnalités, de Christine Lagarde à Moussa Camara. Comment s’est opérée la sélection ?
MP : Je voulais absolument éviter un point de vue unique ou dogmatique. Ce livre, ce n’est pas “mes idées illustrées” : c’est un débat ouvert. La sélection des personnalités – sept femmes et six hommes – a donc été un vrai défi. Avec Mathieu Charrier et Nicoby, nous avons conçu un casting représentatif, pluriel, avec une diversité d’expériences, de secteurs, de parcours. Ensuite, je les ai tous appelés. Et à ma grande joie, tout le monde a accepté. Il y avait un vrai enjeu de représentation : Nicoby – Nicolas Boudin, le dessinateur de l’ouvrage – a trouvé le ton juste, entre humour et réalisme.
Et du côté de la narration, pourquoi avoir choisi le personnage de Soraya, une lycéenne, comme fil rouge de l’histoire ?
MP : Soraya apporte de la fraîcheur, du recul, un zeste d’impertinence et un regard transgénérationnel. C’est elle qui nous emmène dans cette exploration, en tentant de finir son exposé sur le travail de demain. On entre dans des échanges de fond sans jamais perdre la dimension vivante et incarnée du récit. Cela a été possible grâce aux interviews menées avec chacun des treize invités, que l’on a ensuite scénarisées. Notre objectif était de construire une intrigue, pas une succession de tribunes.
Vous parlez d’une transformation inédite du travail. Est-ce que l’on peut parler de crise du travail ?
MP : Je ne dirais pas que c’est une crise, mais un bouleversement profond. Le travail a toujours évolué, mais nous sommes aujourd’hui face à une conjonction inédite de facteurs. Ce qui est nouveau, c’est l’ampleur et la vitesse des mutations. Et si on ne les anticipe pas, si on ne les façonne pas collectivement, alors oui, cela peut devenir une crise. C’est pourquoi il est crucial de débattre dès maintenant du travail de demain. Ce n’est pas un sujet prospectif à dix ans : les décisions se prennent aujourd’hui, et elles modèlent notre avenir.
L’intelligence artificielle est l’un des bouleversements majeurs. Dans la BD, c’est Aurélie Jean qui incarne ce thème. Quel est votre point de vue ?
MP : L’IA est une question clé. Le Fonds monétaire international (FMI) estime que 50 % des emplois dans les pays développés seront impactés d’ici 2030. Et quand je dis “impactés”, cela ne signifie pas nécessairement supprimés, mais profondément transformés. Comme le montre Aurélie Jean, les tâches transactionnelles, répétitives ou pénibles – qu’elles relèvent de la médecine, des RH, de la comptabilité, du droit ou encore de la vente – seront en grande partie automatisées. Mais de nouveaux métiers émergent aussi, comme conducteur de drones professionnels ou thérapeute de l’IA, mentionnés dans la BD.
La véritable transformation réside dans la modification des tâches au sein même des métiers : or, quand 75 % de vos tâches changent, c’est tout votre métier qui évolue. L’IA peut être un levier formidable de progrès, mais elle soulève aussi des risques de dépendance, de perte d’autonomie et de créativité, et bien sûr de biais éthiques.
Justement, comment éviter que l’IA n’aggrave les inégalités ?
MP : Il faut démocratiser la compréhension. Tout le monde – salarié ou citoyen – doit avoir les bases pour interroger une IA, vérifier ses sources, comprendre comment elle est entraînée, identifier ses biais. J’aime beaucoup l’approche de certains enseignants qui demandent aux étudiants de faire une première version de leur devoir avec l’IA, pour ensuite challenger ensemble le raisonnement en classe. Cela développe le discernement, l’esprit critique.
La compétence, c’est votre fil rouge. Vous parlez d’une “société de compétences”. Que voulez-vous dire ?
MP : Aujourd’hui, une compétence professionnelle acquise est valable… à peine deux ans en moyenne, selon l’OCDE. On est bien loin des trente ans constatés autrefois. Cela signifie que travailler et apprendre doivent désormais aller de pair. Il faut former en continu, adapter les parcours, outiller les salariés.
Certaines entreprises mondiales ont d’ailleurs commencé à former l’ensemble de leurs collaborateurs à l’intelligence artificielle. C’est un enjeu à la fois professionnel et citoyen : si l’on ne donne pas à chacun les moyens de comprendre et de maîtriser ces outils, on court le risque d’une nouvelle fracture numérique et sociale — entre ceux et celles qui innovent, et ceux qui subissent.
Dans un monde où tout va vite, où l’IA gomme l’erreur, comment préserver l’envie d’apprendre ?
MP : C’est là que le mode projet devient intéressant. C’est un thème qui a émergé spontanément dans les entretiens : Marylise Léon, Sophie Bellon, Thierry Marx, Aurélie Jean, Jasmine Manet… ont tous évoqué son importance. Les jeunes générations s’engagent différemment. Moins dans les institutions, davantage dans des projets concrets, porteurs de sens (écologie, tech, social…). Et dans l’éducation aussi, le mode projet permet d’articuler théorie, pratique et transversalité.
La transition écologique est un autre sujet central. Est-elle réellement intégrée par les entreprises, ou est-ce encore du greenwashing ?
MP : Cela dépend. Certaines entreprises ont une vraie stratégie de transformation – comme Saint-Gobain, avec Benoît Bazin dans la BD. Il s’agit d’un changement profond du modèle d’affaires sur toute la chaîne de valeur, impliquant le sourcing, la production ou encore la logistique. Sophie Bellon, Pascal Demurger et Moussa Camara montrent d’autres exemples. D’autres entreprises en sont encore à une logique de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ponctuelle, ou à des effets de manche. Mais la directive européenne CSRD pousse dans le bon sens. Et on observe que lorsque l’écologie entre dans la stratégie, cela devient structurel – et cela attire aussi les jeunes talents.
Dernier thème fondamental : l’égalité femmes-hommes. Pourquoi les inégalités persistent-elles malgré le cadre légal ?
MP : C’est une question culturelle et systémique. Isabelle Rome l’exprime très bien dans la BD, mais elle n’est pas la seule : Christine Lagarde, Marylise Léon, Philippe Martinez ou encore d’autres personnalités en parlent également. Il y a bien sûr les plafonds de verre dans l’entreprise, mais aussi les violences faites aux femmes, qui ont un impact direct sur leur capacité à se projeter professionnellement. Le non-partage des tâches domestiques reste également un frein majeur. Et il faut encore lutter contre les biais inconscients, que ce soit dans l’éducation, le recrutement ou la formation.
On progresse tout de même : la France et l’Espagne sont aujourd’hui en tête en Europe sur ce sujet, selon les derniers baromètres. Mais ce combat ne sera jamais terminé. Et ce n’est pas seulement un enjeu “féministe” : les entreprises paritaires sont plus performantes, plus innovantes, plus résilientes.
Cela dit, le contexte géopolitique mondial ne facilite pas les choses. On observe, dans plusieurs pays, un recul sur les droits des femmes et les libertés fondamentales : ces dynamiques régressives pèsent sur la manière dont les entreprises abordent, ou non, l’égalité et la diversité. Il est donc d’autant plus crucial de ne rien lâcher sur ces sujets, comme le disait Simone de Beauvoir — elle est d’ailleurs citée dans la BD.
Vous êtes aussi photographe. Si vous deviez capturer une image du travail de demain, qu’elle serait-elle ?
MP : Une de mes photos s’intitule Homo Numericus. C’est le visage d’un homme traversé de chiffres. Elle interroge notre avenir : est-ce que notre cerveau va devenir un ordinateur ? C’est une métaphore de ce monde en transformation. L’IA est là. Mais l’avenir dépend de ce qu’on en fait.