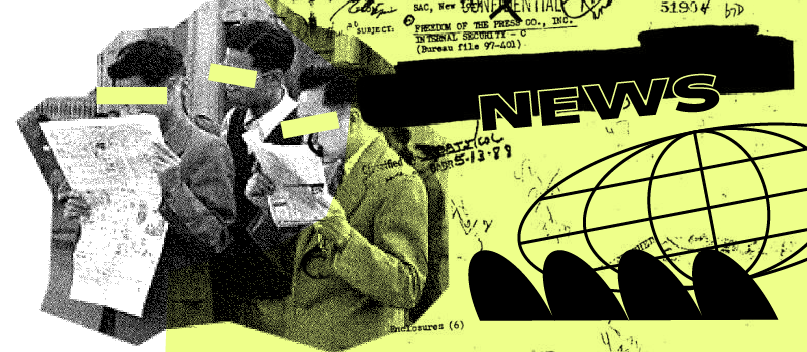Le paysage médiatique autour de l’IA suscite une profusion d’analyses, de prises de parole sur ses impacts sociétaux, politiques, géopolitiques et économiques. Omniprésents, les débats tous azimuts s’imposent avec une intensité remarquable. Mais, à y regarder de plus près, la prolifération de nouveaux “spécialistes” autoproclamés de l'IA, particulièrement ces deux dernières années, est spectaculaire. Il suffit d’observer l’abondance des interventions “expertes” sur les réseaux sociaux et dans d’autres espaces publics : publications et commentaires prolixes, “coachs” en IA, masterclasses express, conférences à la chaîne et formations éclair en IA générative. Le constat s’impose : chacun y va de son analyse, de ses références et de ses concepts, parfois mal compris ou approximatifs. Loin de gagner en rigueur, le débat public se trouve souvent noyé sous des considérations relevant de pseudo-philosophie, de pseudo-science ou de pseudo-sciences politiques, ce qui met en évidence les limites d’une expertise hâtive et d’une réflexion peu documentée. On pourrait en sourire, et parfois s’en amuser, si cela ne révélait pas un autre constat plus inquiétant : une méconnaissance, voire une ignorance, de la culture numérique, entendue non seulement comme la maîtrise des outils, mais aussi comme la compréhension des logiques, des enjeux et des dynamiques sociotechniques qui façonnent notre époque.
L'alliance des sciences humaines et des technologies
Il existe pourtant une discipline académique, encore peu connue du grand public, qui permet d’aborder ces champs de savoirs de manière structurée, rigoureuse et surtout transversale : les « Humanités numériques », ou « Digital humanities » en anglais. Cette discipline explore l’application des technologies numériques, et a fortiori de l’IA, aux domaines des sciences humaines et sociales. Elle réunit des chercheurs - ingénieurs, scientifiques, designers, historiens, philosophes, sociologues, économistes - qui utilisent des outils technologiques pour analyser, traiter et diffuser des données culturelles, historiques, politiques, économiques, linguistiques ou sociales. L’objectif est de comprendre les phénomènes humains, ainsi que les enjeux et impacts de nos rapports aux objets numériques, quel que soit leur domaine, à travers ces technologies, tout en exploitant les innovations de ces outils pour découvrir de nouvelles dimensions des savoirs.
Plusieurs institutions et universités développent, enseignent et font avancer les recherches en humanités numériques. Parmi elles, on compte l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’École nationale des chartes (Université PSL-ENS), l’Université Paris 8, l’Université Paris-Saclay, Sciences Po, ainsi que l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse. Aux États-Unis, des institutions telles que l’Illinois Institute of Technology, le MIT et l’Université de Stanford jouent également un rôle dans ce domaine.
Un éclairage critique pour comprendre l'IA
Appliquées aux sciences de l’IA, les humanités numériques sont essentielles pour une compréhension approfondie des technologies algorithmiques. En intégrant les méthodologies des sciences humaines et sociales, elles offrent un cadre critique permettant d'analyser et de décrypter les discours, les stratégies, les usages et les innovations qui façonnent l’écosystème économique et social de l’IA, ainsi que sa trajectoire et ses répercussions. L’interdisciplinarité favorise la collaboration, la diversité culturelle et entrepreneuriale, en mobilisant des compétences et des savoirs à la fois techniques et non techniques, notamment dans la conception, le développement et l’usage des algorithmes. Elles interrogent les processus d’analyse des données collectées, les risques associés à certains modèles d’IA et examinent les approches de design numérique, les problématiques ergonomiques, les techniques de captation cognitive, et l’évolution des usages selon les environnements économiques et sociaux.
Une clé de réussite pour les entreprises
Les entreprises et les entrepreneurs ont tout à gagner à intégrer les humanités numériques dans leurs projets d’IA. Cette discipline contribue directement à leur stratégie, à leur performance technique, à leur compétitivité et à leur capacité d’innovation. En enrichissant les technologies algorithmiques par une compréhension approfondie des comportements humains, des dynamiques culturelles et des usages réels, elle permet d’optimiser l’expérience client en proposant des produits et services plus intuitifs, inclusifs et adaptés, tout en protégeant l’entreprise des risques réputationnels liés aux biais et aux discriminations technologiques. En stimulant la créativité, les humanités numériques favorisent la conception et le développement de solutions innovantes sur le marché, notamment à travers la recherche. Elles renforcent également la veille stratégique en aidant à anticiper les tendances, à analyser l’évolution des pratiques numériques intégrant l’IA, et à mieux appréhender les controverses qui lui sont associées. Surtout, elles stimulent l’intelligence collective au sein des entreprises, à travers la collaboration entre les différents métiers.
Dans un panorama médiatique saturé de prospectives sur l'IA et ses impacts sur la société, l'intégration continue de la culture numérique représente un atout essentiel pour faire progresser nos “humanités” à tous. Face à la complexité et à la richesse des technologies algorithmiques, cet apprentissage permet d'apporter à la fois rigueur critique et recul nécessaire pour naviguer, avec responsabilité, dans un monde économique en constante évolution.