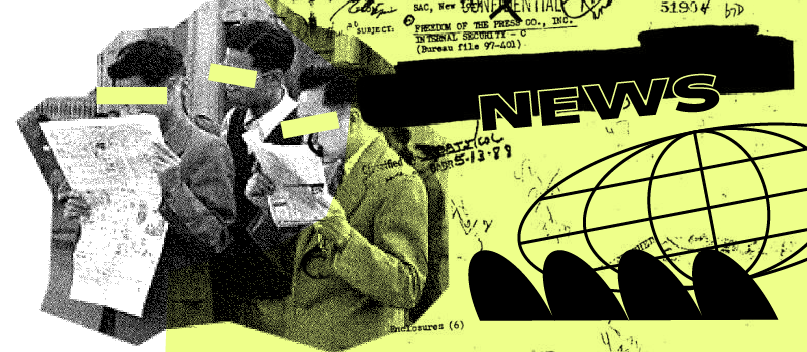La pensée écologique soulève des questionnements inédits quant à la relation entre la nature et l’entreprise. En effet, de récentes initiatives démontrent que de « simple ressource exploitée » par les entreprises, les non-humains commencent à disposer « d’une voix » plus stratégique dans les gouvernances. Il s’agit d’une révolution dans la pensée naturaliste (séparation nette entre nature et culture) dominante. Elle s’inscrit dans le concept de l’écosophie, forgé par le philosophe Arne Næss en 1960, qui invite à un renversement de la perspective anthropocentriste : « L’homme ne se situe pas au sommet de la hiérarchie du vivant, mais s’inscrit au contraire dans l’écosphère comme une partie qui s’insère dans le tout. »
C’est dans le sillage des anthropologues et philosophes Philippe Descola et Bruno Latour que Frantz Gault, cofondateur d'Ultra Laborans, une agence qui accompagne les métamorphoses du travail, a écrit son dernier ouvrage, « La nature au travail : Collaborer autrement avec le vivant ». Son objectif ? Nous aider à comprendre et à déconstruire la scission artificielle entre nature et culture, qui alimente un système délétère. Il nous invite à réconcilier le travail avec l'environnement naturel à travers différents scénarios possibles.
Maddyness : Pourquoi vous êtes-vous interrogé sur la relation que nous entretenons avec la nature, notamment par l’intermédiaire de l’entreprise ?
Frantz Gault : En 2020, je suis allé en Amazonie pour réaliser un documentaire, Natura Naturans, qui interrogeait déjà le concept de nature. Ça m’a amené à réfléchir sur l'applicabilité de l’écologie à notre économie afin de repenser notre système économique de manière radicalement différente. Or, de retour en France, j'ai constaté que la littérature écologique n'était pas à la hauteur des enjeux de l'anthropocène, une nouvelle époque géologique marquée par l'impact significatif des activités humaines sur la Terre et ses systèmes (un terme qui fait débat).
Philippe Descola, dont vous avez suivi les cours au Collège de France, dit que la nature n'existe pas, qu’elle a été inventée. Cela remet en cause notre approche naturaliste occidentale : pouvez-vous revenir sur cette séparation « imaginaire » entre homme et nature, son origine et ses impacts ?
Dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains n'ont jamais considéré que les non-humains – animaux, plantes, etc. – partageaient les mêmes qualités, notamment celle d'avoir une âme. Avec la modernité et la Révolution, seuls les humains ont été reconnus comme possédant un esprit, tandis que les non-humains étaient réduits à de la simple matière. Cette vision du monde, dite naturaliste, a été façonnée par la science, qui a réinterprété le monde naturel comme une chose, une ressource. C'est à ce moment-là que le concept de nature a été inventé.
M : D’autres courants de pensée s’opposent à cette vision : quels sont-ils ?
F.G : Dans le monde naturaliste dans lequel nous évoluons, seule la valeur de l'humain est reconnue. Les trois autres écoles de pensée proposent une distribution différente de cette valeur. L’animisme, ou son versant occidental appelé biocentrisme, attribue de la valeur à tous les êtres vivants. La pensée écosystémique va encore plus loin en insistant sur la préservation des composantes du système Terre, bien qu'elle soit ambiguë quant à la place qu'occupent les êtres vivants. Enfin, il y a l'écoumène, qui désigne une communauté locale composée de familles d’êtres vivants interdépendants, cherchant à bien vivre ensemble.
M : Votre ouvrage pose une question fondamentale pour notre futur : comment réconcilier vivant et entreprise en dépassant la relation d’exploitation. Vous proposez un premier scénario qui est de « salarier » les non-humains. Pouvez-vous nous l’expliquer ?
F.G : Si nous revalorisons les organismes non-humains, nous cessons de les considérer comme de simples ressources. On peut faire une analogie avec l’évolution du travail humain : lorsque nous avons cessé de considérer les Hommes comme des esclaves, ils ont pu s’émanciper, devenir des salariés. Les organismes non-humains pourraient être traités ainsi. C’est déjà en partie le cas pour certains mammifères dans l'industrie du spectacle ou les animaux d’élevage : le code du travail de l’animal comptabilisant près de 1.700 pages existe ! Il est possible d’aller plus loin en envisageant des mesures comme la sécurité sociale, les congés payés et la retraite pour ces animaux. Par exemple, j’ai appris que dans le Nord, les chevaux travaillant dans les mines avaient droit à des congés payés.
M : Vous proposez deux autres scénarios - avec des exemples réels - pour positionner la nature à des niveaux encore plus stratégiques. Quels sont-ils ?
F.G : La théorie des parties prenantes (Stakeholder theory) part du principe que le système Terre n'existe pas en tant qu'entité indépendante, mais est plutôt une construction scientifique. Cependant, nous pouvons considérer ces systèmes naturels comme des parties prenantes qui participent à la vie de l’entreprise et apportent des services. Faith in Nature, une compagnie de cosmétiques écossaise, a annoncé dédier un des sièges de son conseil à un administrateur représentant de la nature. Le rôle est pris en charge par un binôme issu de deux associations, Lawyers for Nature et le Earth Law Center. Ce modèle permet d'associer ces parties prenantes aux décisions de l'entreprise et de leur accorder un droit de vote.
Autre niveau encore plus stratégique : l’actionnariat des entités naturelles. Nous, les humains, appartenons à des communautés locales telles que les fleuves, les forêts et les glaciers. Celles-ci peuvent devenir actionnaires de nos entreprises ou, pourquoi pas, des entreprises à part entière. À titre d’exemple, Patagonia a attribué à la nature le rôle d'actionnaire majoritaire en attribuant 98 % de ses actions à la Holdfast Collective. Bien que ce ne soit pas parfait (pas de droit de vote), c'est un excellent début pour intégrer la nature dans la gouvernance des entreprises.
M : Dans ces trois scénarios, la représentativité de la nature semble être tout de même un enjeu. Comment doit-elle être assurée ? Par qui ? Comment ?
F.G : Il faut d’abord déterminer ce que nous représentons, avant de décider qui doit le faire. Pour l’option du salariat, la représentation peut se faire via des syndicats, à l’instar des éco-syndicats ou des associations pour les droits des animaux. Dans le deuxième scénario, lorsqu'il s'agit d’écosystèmes, on peut faire appel à des scientifiques pour assister au CODIR ou au COMEX… mais cela ne suffit pas. Il faut aussi répondre aux enjeux juridiques : en ce sens, ne faudrait-il pas également des avocats et des juristes pour défendre le droit des écosystèmes ?
Quant au troisième scénario, qui peut représenter les entités naturelles locales ? Est-ce les élus locaux ? Les habitants ? Les personnes qui travaillent la terre ? Ma recommandation est d'éviter de confier cette représentation de la nature à une seule personne. Au niveau du conseil d'administration ou de l’assemblée des actionnaires, la nature est complexe et nécessite une pluralité de points de vue. Il est préférable d'avoir deux représentants : par exemple, une personne interne et une personne externe afin de mêler impératif écologique et réalité du terrain opérationnel.
M : Quel est le scénario à privilégier d’après vous ?
F.G : Pour y répondre, il faut ajouter un paramètre important : la territorialité. En effet, dans un contexte de mondialisation, les entreprises capitalistes se sont beaucoup déracinées via des stratégies comptables ou fiscales. L’internationalisation et la complexité organisationnelle empêchent de rendre des comptes à un territoire ou à une législation spécifique. En ce sens, en acceptant de se soumettre à des contraintes naturelles spécifiques, le troisième scénario propose une reterritorialisation des entreprises. C’est aussi le seul scénario qui donne le pouvoir souverain à la nature : en la positionnant au niveau de l’actionnariat, on la place là où réside le pouvoir en entreprise. C’est une sorte de marxisme vert : un modèle où la propriété des moyens de production n'appartient plus au capital ou à l'État, mais à la nature.
M : Peut-on être optimiste pour la suite ?
F.G : Si l’on regarde de plus près, je pense que nous ne sommes pas totalement naturalistes. Il existe une forme d’animisme et de totémisme (système de croyances où des groupes humains entretiennent des relations symboliques avec des entités naturelles, souvent des animaux ou des plantes), notamment visible dans les écovillages qui se développent. Je suis convaincu que c’est en développant un rapport quotidien avec la nature, en la ressentant dans notre réalité, que nous pouvons créer une relation de respect avec le vivant et tisser des liens solides.